Il m'a paru intéressant de reproduire ici quelques
"recettes" utilisées par les premiers photographes. Il est en effet curieux
de constater que de nombreux problèmes techniques d'aujourd'hui... étaient déjà d'actualité en
1900.
Un exemple ? Protéger une photographie contre la
contrefaçon.
 |
e
ATTENTION f
Les photographes vers 1900 étaient certes artistes mais ils étaient également
aussi un peu chimistes. Du moins avaient-ils les notions minimum leur
permettant de manipuler des produits aussi dangereux que le Cyanure ou
l'acide sulfurique.
Les solutions chimiques données dans ces pages ne le
sont qu'à titre strictement historique. Je vous déconseille fortement
de tenter de les reproduire. Il en va de votre santé ! |

Coloriage
des photographies
Soit qu’on veuille la retoucher ou la colorier : on est souvent gêné
pour faire prendre la couleur sur une photographie.
Il suffit de promener à la surface de l’image une pomme de terre
fraîchement coupée : la couleur prend immédiatement aux endroits ainsi
traités.
Protection des photographies contre la contrefaçon
Baigner partiellement une photographie dans une forte solution aqueuse
de sulfate de quinine. Après séchage, la partie de l’épreuve ainsi traitée
ne présente aucune modification visible. Si l’on tente de re-photographier
cette épreuve, les parties traitées avec le sulfate de quinine
apparaîtront, sur les négatifs, beaucoup plus sombres que les autres. Les
solutions d’esculine et de bisulfate de cinchonine agissent d’une manière
analogue.
L’action d’une solution diluée de fluorescéine est encore plus énergique :
on tamponnera l’image avec un timbre caoutchouc humecté de la solution
suivante :
 En peu de temps, l’image disparaît d’une
façon à peu près complète. Passé ce délai, on lave l’image à grande eau
puis on la plonge dans l’ammoniaque dilué.
En peu de temps, l’image disparaît d’une
façon à peu près complète. Passé ce délai, on lave l’image à grande eau
puis on la plonge dans l’ammoniaque dilué.
L’image réapparaît rapidement
avec un ton brun ou noir et d’une bien meilleure intensité.
Pour remplacer le verre dépoli des
chambres noires
On obtient un écran dépoli beaucoup plus fin que le meilleur verre
dépoli du commerce en exposant durant quelques secondes une plaque au
gélatino-bromure à la lumière d’une bougie. On développe cette plaque
jusqu’à ce qu’elle ait pris une teinte assez foncée et on la fixe. Après
lavage, on blanchit la couche dans une solution de bichlorure de mercure.
On lave de nouveau et on laisse sécher.
Retouche des épreuves sur papier à la
celloïdine
Sauf à lui avoir fait subir un traitement préalable, il est difficile
de retoucher avec des couleurs à l’eau des épreuves sur du papier
brillant. Pour ce faire, étendre sur l’image quelques gouttes d’essence de
térébenthine et faire évaporer l’excès à une douce chaleur.
Pour que votre couleur, en séchant, ne devienne pas terne mais conserve
son brillant, il convient de mélanger à celle-ci quelques gouttes d’une
solution de gomme arabique ou d’albumine. La solution d’albumine se
prépare en versant un blanc d’œuf dans un flacon de 100 cc de capacité
auquel on ajoute 1 à 2 cc d’ammoniaque liquide. Remplissez d’eau le flacon
et agiter.
Préparation des verres inactiniques
pour lanternes de laboratoire
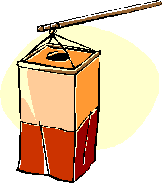 Plonger
deux vieilles plaques au gélatino-bromure dans une solution d’hyposulfite
à 20% additionnée d’une petite quantité de solution de cyanure rouge (Ce
traitement a pour effet de dissoudre le sel d’argent qui recouvre ces
plaques).
Plonger
deux vieilles plaques au gélatino-bromure dans une solution d’hyposulfite
à 20% additionnée d’une petite quantité de solution de cyanure rouge (Ce
traitement a pour effet de dissoudre le sel d’argent qui recouvre ces
plaques).
Une fois cette dissolution achevée, laver les deux plaques avec soin et
procéder à leur teinture. Pour ce faire, on plonge l’une des deux plaques
dans une solution de 3 gr de Violet de méthyle dilués dans 1000 cc d’eau
et l’autre plaque dans une solution de 6 gr de Tartrazine dilués dans 1000
cc d’eau.
Laisser les plaques un quart d’heure dans ces bains colorants puis les
rincer légèrement et les faire sécher.
Après les avoir superposer couche contre couche, on les réunit par une
bordure de papier. On obtient alors un écran qui ne transmet que les
radiations de l’extrême rouge du spectre. On pourra utiliser cet écran
devant le faisceau d’une lanterne lorsque l’on doit travailler en
laboratoire.

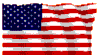
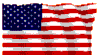
Nombre
de visiteurs